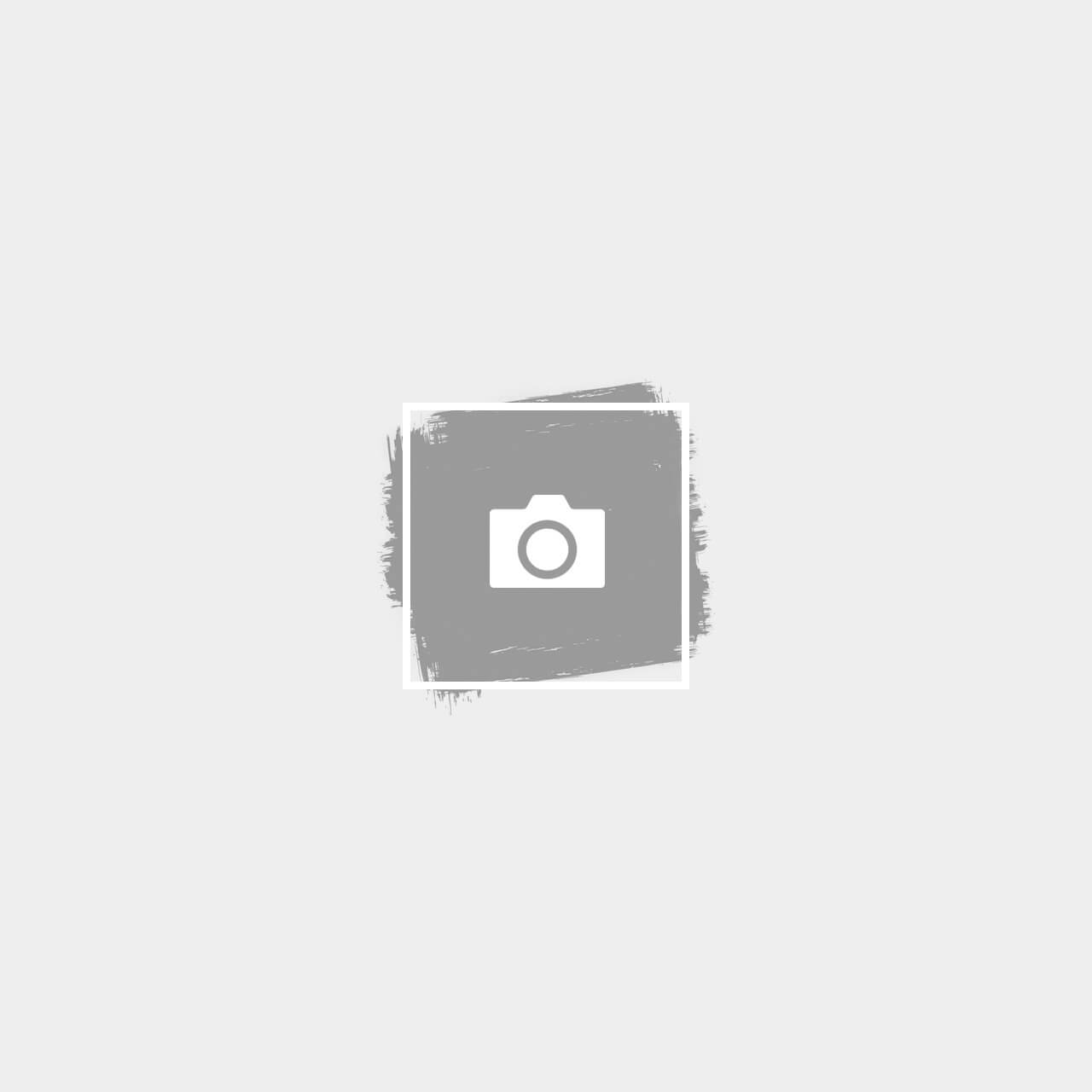Traduction d’un article publié par le journaliste Fred Pearce le 19 janvier 2010 dans la revue Yale Environment 360.
Le modèle traditionnel des parcs, consistant à fermer des zones et à empêcher les gens d’y entrer, risque de ne pas fonctionner en Afrique où les populations sont attachées à leurs terres. Ce qu’il faut, c’est une approche qui permette aux humains et aux animaux de coexister.
Le monde a un modèle pour la conservation : les aires protégées. Les États-Unis ont inventé ce modèle avec leurs grands parcs nationaux qui protègent des zones sauvages vierges. Mais que faire si le modèle est erroné ? Et s’il était voué à l’échec dans un monde surpeuplé où la plupart des espèces vivent le plus clair de leur temps en dehors des zones protégées ?
Cette année est l’année internationale de la biodiversité. Ce sera une année où les appels à la création de nouveaux parcs se multiplieront afin de mettre un terme à la perte sans précédent d’espèces dans le monde entier. Ces appels viendront en particulier des groupes environnementaux traditionnels comme le WWF, The Nature Conservancy et Conservation International, pour qui la protection des « points chauds » de la biodiversité sur les terres – qu’ils possèdent ou gèrent – est une activité essentielle.
Il y a de plus en plus de parcs chaque année. Et pourtant, malgré cela, la conservation échoue. La Convention sur la biodiversité, signée au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, et la promesse d’enrayer la disparition des espèces faite dix ans plus tard au Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, n’ont fait guère plus que d’empêcher l’accélération des pertes. Peut-être l’idée même d’isoler la nature sauvage de l’activité humaine est-elle fatalement erronée, une mauvaise interprétation de nos relations symbiotiques avec la nature.
Le problème est que ce qui fonctionne dans les grands espaces des États-Unis – dans les parcs nationaux de Yellowstone et de Yosemite – peut ne pas fonctionner ailleurs, là où il y a plus de monde et où les demandes en terres sont bien plus importantes. Le banc d’essai sera probablement l’Afrique, un endroit où sont concentrés plus de grands mammifères que partout ailleurs dans le monde.
C’est en Afrique que le modèle américain de conservation des parcs a été expérimenté pour la première fois dans l’environnement international. Tout a commencé avec le parrain des parcs nationaux américains, le président Theodore Roosevelt, et un safari de chasse, probablement le plus grand et le plus célèbre safari jamais organisé.
Il y a cent ans cette année, le président américain de l’époque, récemment retraité, passait un an avec son fils Kermit dans la brousse africaine. Au final, ils ont envoyé chez eux plus de 10 000 carcasses, dont la plupart à la Smithsonian Institution. Aujourd’hui encore, un de ses rhinocéros blancs, convenablement empaillé, occupe une place de choix dans la salle des mammifères du Musée national d’histoire naturelle de l’Institution, à Washington, D.C.
Cette orgie de massacres, perpétrés dans ce que Roosevelt appelait « le meilleur de tous les grands terrains de chasse du monde », a été une grande nouvelle pour le pays, et a renforcé la perception du monde extérieur de l’Afrique comme un paysage primitif grouillant de gnous et d’éléphants, de lions et de zèbres. Peu d’années après, les anciens chasseurs sont devenus les fondateurs des grands parcs nationaux qui couvrent toujours une grande partie du continent. Pour eux, la chasse et la conservation allaient de pair. Ils croyaient protéger un paysage sauvage, les derniers grands terrains de chasse du monde.
Pourtant, il s’agissait là d’un mythe à grande échelle, car une grande partie de l’Afrique « primitive » que Roosevelt avait sous les yeux était âgée de moins de vingt ans. Et les grands parcs d’aujourd’hui sont, sur le plan écologique, aussi artificiels qu’un jardin de campagne anglais. Cette interprétation erronée du paysage et de la conservation se trouve au cœur de nombreux problèmes auxquels les conservationnistes sont confrontés aujourd’hui.
Que s’est-il donc passé en Afrique il y a cent ans ? Pourquoi cette mauvaise interprétation ?
L’histoire a commencé lorsqu’un corps expéditionnaire italien est arrivé dans la Corne de l’Afrique en 1887. La petite bande a ramené avec elle du bétail d’Asie porteur d’un passager dangereux – un virus du bétail qui provoque une maladie appelée peste bovine. Originaire des steppes de l’Asie centrale, ce proche parent de la rougeole et de la maladie de Carré avait périodiquement balayé l’Europe, mais était inconnu en Afrique subsaharienne.
Le virus s’est rapidement propagé au bétail indigène et a voyagé depuis l’Érythrée, à travers l’Éthiopie, sur des pistes au sud le long de la vallée du Rift et à l’ouest à travers le Sahel. Les autorités coloniales britanniques en Afrique australe ont tenté d’arrêter le passage de la maladie en érigeant une clôture de fil barbelé de 1 000 miles [environ 1 600 km, NdT] et en abattant le bétail infecté. En vain.
Cette pandémie est sans doute la plus grande calamité naturelle qui ait jamais frappé l’Afrique. « Jamais auparavant dans la mémoire de l’homme, ou par la voix de la tradition, le bétail n’avait été tué en si grand nombre ; jamais auparavant le gibier n’avait souffert… L’étendue énorme de la dévastation ne peut guère être exagérée », a écrit Frederick Lugard, un capitaine de l’armée britannique qui a parcouru les routes des caravanes du nord du Kenya en 1890.
La peste bovine ne s’attaque qu’aux animaux à sabots fendus, mais indirectement, elle a également dévasté la population humaine. Les bergers n’avaient plus de bétail. Les fermiers n’avaient pas de bœufs pour tirer leurs charrues ou actionner les roues hydrauliques qui irriguaient les champs. Les populations affamées étaient victimes de maladies telles que la variole, le choléra et la typhoïde.
Les chercheurs modernes n’ont pas estimé le nombre de morts, mais Lugard a écrit : « Partout, les gens que je voyais étaient maigres et à moitié affamés, et couverts de maladies de peau. Ils ne disposaient d’aucune culture vivrière pour remplacer le lait et la viande qui constituaient leur alimentation naturelle ». Par endroits, les épidémies coïncidaient avec la sécheresse. Entre 1888 et 1892, environ un tiers de la population éthiopienne – soit plusieurs millions de personnes – aurait péri.
Les grandes cultures pastorales du continent ont été anéanties. Les tribus d’éleveurs de bétail d’Afrique centrale, comme les Tutsis et les Karamajong, sont mortes de faim, de même que les nations soudanaises comme les Dinka et les Bari, les Africains de l’Ouest comme les Fulani, et les Africains du Sud comme les Nama et les Herero. Le folklore des Massaïs d’Afrique de l’Est évoque l’enkidaaroto, la « destruction » de 1891. Ils ont perdu la plupart de leur bétail et les deux tiers des Massaïs sont morts. Un ancien s’est souvenu plus tard que les cadavres étaient « si nombreux et si proches les uns des autres que les vautours avaient oublié comment voler ».
Pour beaucoup de ces sociétés, les populations ne se sont pas rétablies. Et il en va de même pour leur richesse et leur pouvoir. La peste bovine a servi le continent sur un plateau aux colonialistes européens. Dans son sillage, les Allemands et les Britanniques ont pris le contrôle de la Tanzanie et du Kenya sans presque avoir besoin de livrer bataille. En Afrique australe, les Zoulous affamés et démunis ont migré vers les mines d’or du Witwatersrand, contribuant à créer cette brutale fracture sociale entre les noirs et les blancs d’où est né l’apartheid.
C’est une histoire extraordinaire, rarement contée, mais ses ramifications ne se sont pas arrêtées avec la « ruée vers l’Afrique ». Paradoxalement, ce cataclysme pour la faune a créé le « paysage primitif » découvert par Roosevelt et ses compagnons de chasse.
Comment cela se fait-il ? Tout d’abord, l’épidémie a tué d’énormes quantités d’animaux sauvages indigènes. Mais elle a créé un paysage idéal pour la propagation de la mouche tsé-tsé, qui, aujourd’hui encore, est le deuxième obstacle au développement de l’Afrique après le sida.
La mouche tsé-tsé vit dans la brousse tropicale des basses terres. Elle est porteuse de la trypanosomiase, une maladie souvent endémique chez les animaux sauvages tels que les ruminants qui possèdent probablement une certaine immunité. Mais la maladie peut provoquer des épidémies généralisées chez le bétail et les humains, chez qui elle est connue sous le nom de maladie du sommeil. Les mouches tsé-tsé aiment la végétation luxuriante où les adultes peuvent déposer leurs larves. Avant l’arrivée de la peste bovine, les troupeaux de bétail des éleveurs des plaines africaines avaient toujours empêché la propagation de la tsé-tsé en broutant la végétation de la brousse. Mais la peste bovine ayant décimé le bétail, la végétation ligneuse s’est développée rapidement. Ainsi, une fois l’épidémie passée, lorsque les populations d’animaux sauvages ont repris beaucoup plus vite que le bétail, les mouches tsé-tsé se sont rapidement répandues dans la brousse qu’elles ne pouvaient pas occuper auparavant.
Les mouches – et la maladie du sommeil qu’elles transportaient – empêchaient à leur tour les humains et leur bétail de retourner paître dans la brousse. En Afrique de l’Est, les régions montagneuses où le bétail s’était jusqu’à récemment déplacé librement sont rapidement devenues des zones de brousse et de forêt infestées par la mouche tsé-tsé. En Afrique australe, la mouche s’est répandue dans les vallées du Zambèze et du Limpopo, créant des zones interdites au bétail là où il avait jadis prospéré.
De cette façon, la peste bovine a créé une révolution écologique contre les hommes et le bétail, en faveur de la faune sauvage. L’Afrique ne s’est jamais complètement remise. Un demi-million de personnes contractent probablement la maladie du sommeil chaque année, environ 100 000 en meurent. La mouche tsé-tsé reste un obstacle majeur au développement économique de régions entières. L’insecte prospère souvent dans les plaines les plus fertiles qui feraient un endroit idéal pour l’élevage de bétail.
Pour les conservationnistes, cela fait de la maladie du sommeil « le meilleur garde-chasse d’Afrique ». Mais elle a également faussé notre perception de l’Afrique. Les colons européens « ont simplement supposé que l’Afrique, qu’ils trouvaient rempli d’animaux et vide d’humains, était dans cet état depuis toujours », dit John Reader, auteur de Africa : A biography of the Continent. Julian Huxley, directeur de l’UNESCO et cofondateur du WWF au début des années 1960, décrit les plaines d’Afrique de l’Est comme « un lieu hérité du riche monde naturel tel qu’il était avant l’avènement de l’homme moderne ».
Dans leur ignorance, les conservationnistes ont créé les grands parcs nationaux africains dans des régions où la peste bovine avait récemment détruit la société humaine : le Serengeti et le Massai Mara, le Tsavo et le Selous, le Kafue, l’Okavango, le Kruger, et les autres. Ils ont décrété que les humains et leur bétail devaient désormais être exclus, peu importe le prix. L’un des plus célèbres de ces défenseurs de l’environnement, le biologiste allemand Bernhard Grzimek, auteur en 1960 du livre Serengeti Shall Not Die et réalisateur du film du même nom, a travaillé inlassablement pour maintenir les Massai hors du Serengeti. « Un parc national doit rester un morceau de nature sauvage primordiale pour être efficace », écrivait-il. « Aucun homme, pas même les autochtones, ne devrait vivre à l’intérieur de ses frontières. Le Serengeti ne peut pas accueillir à la fois des animaux sauvages et du bétail domestique. »
C’est l’image de la conservation que nous perpétuons encore aujourd’hui. Mais elle est construite sur un mythe. Ce n’est que récemment que les chercheurs ont réalisé qu’avant la peste bovine, le bétail et le gibier sauvage coexistaient dans les plaines d’Afrique.
« Les pasteurs ont guidé leurs troupeaux en harmonie avec la faune sauvage pendant des milliers d’années », explique Robin Reid, qui était jusqu’à l’année dernière écologue à l’Institut international de recherche sur l’élevage à Nairobi. En excluant le bétail de vastes zones, les conservationnistes coloniaux et leurs successeurs ont détruit cette dynamique de coexistence et l’ont remplacée par une idéologie de conservation basée sur la séparation – la nature d’un côté de la barrière, l’humanité de l’autre. Mais en poursuivant cet objectif, nous essayons de reconstituer quelque chose qui n’a pas existé depuis des milliers d’années.
Et pas seulement dans les plaines d’Afrique. Les chercheurs en forêt tropicale, de l’Amazonie et de l’Amérique centrale aux jungles d’Afrique et de Bornéo, ont récemment découvert qu’il n’existe probablement aucune forêt tropicale vraiment vierge dans le monde. Avant 1492, l’Amazonie était infestée d’humains. La plupart des forêts d’Afrique centrale ont été consumées au moins une fois pour la fonte du fer. En fixant comme idéal une nature vierge, les conservationnistes cherchent à préserver une version de la nature sauvage qui n’existe probablement plus dans la plupart des régions du monde depuis des milliers d’années.
La coexistence entre l’homme et la faune sauvage est-elle possible ? Dans quelques régions d’Afrique, où les communautés rurales peuvent bénéficier des bénéfices du tourisme de la faune et de la flore sauvages et même de la chasse aux trophées, un nouvel arrangement a été trouvé. Peut-être trouvera-t-on d’autres modèles au XXIe siècle.
Peut-être qu’un siècle après que Roosevelt ait dégainé ses fusils dans la brousse africaine, les parcs doivent être remplacés par une nouvelle approche de la conservation de la faune sauvage : une approche basée non pas sur la séparation mais sur la coexistence entre la faune sauvage et l’homme.