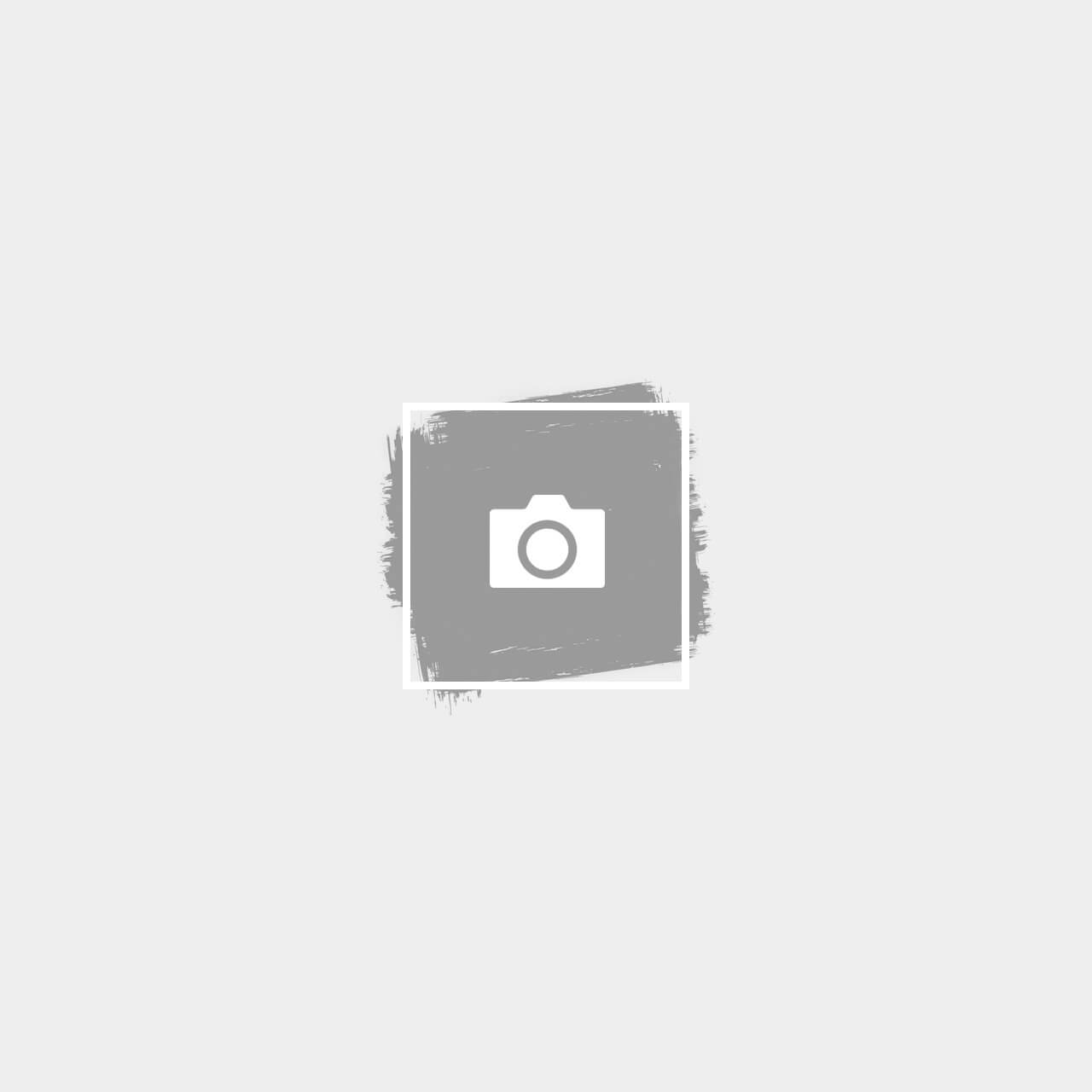Traduction d’un article traitant de la culture chez les animaux sauvages publié dans le magazine The Atlantic en 2018. En protégeant les populations sauvages d’éléphants ou de zèbres, les rangers ne préservent pas seulement une espèce, ils sauvegardent la culture propre à chaque groupe. Cette dernière est essentielle à leur survie.
Le mouflon et l’orignal apprennent à migrer les uns des autres au sein de leurs communautés respectives. Lorsqu’ils disparaissent, ce savoir-faire générationnel n’est pas facilement remplacé.
Dans les années 1800, il y avait tellement de mouflons dans le Wyoming que lorsqu’un trappeur est passé par Jackson Hole, il décrivait « plus de mille moutons dans les falaises au-dessus de notre campement. » De tels paysages vivants n’existent plus aujourd’hui. Les mouflons sont lentement tombés sous les balles des chasseurs, et ont succombé aux maladies transmises par les moutons domestiques. La plupart des troupeaux ont été anéantis et, en 1900, l’espèce qui comptait autrefois des millions d’individus n’en comptait plus que quelques milliers.
Dans les années 1940, le Wyoming Game and Fish Department a commencé à essayer de ramener les mouflons dans leurs habitats historiques. Ces relocalisations se poursuivent aujourd’hui, et elles ont permis de restaurer les troupeaux disparus avec de plus en plus de succès. Mais les animaux perdus ne sont pas seulement des individus perdus, leur savoir est également mort avec eux, et il n’est pas facile de le remplacer.
Par exemple, les mouflons migrent. Au printemps, ils grimpent sur des dizaines de kilomètres en terrain montagneux, « surfant » les vagues vertes de jeunes pousses nouvellement apparues. Ils apprennent les meilleurs itinéraires les uns des autres, au fil des décennies et des générations. C’est pourquoi un mouflon d’Amérique qui est relâché en terrain inconnu est un novice en matière d’écologie. Ce n’est pas la même chose pour un individu qui a vécu toute sa vie dans cet endroit et qui a été guidé par une mère instruite.
« Les animaux transférés ont littéralement été sortis d’une remorque à bétail et ont commencé à examiner leur nouvel environnement », explique Matthew Kauffman de l’université du Wyoming. « Et ils n’ont presque pas réussi à migrer. »
Kauffman le sait car les moutons transférés étaient souvent munis de colliers émetteurs, ce qui lui permettait, ainsi qu’à ses collègues, de comparer leurs mouvements à ceux des mouflons qui ont vécu au même endroit pendant des siècles. Au sein de ces troupeaux de longue date, entre 65 et 100 % des moutons ont migré. Mais dans les troupeaux déplacés, moins de 9 % ont migré – seulement les moutons qui avaient été déplacés dans des populations établies qui connaissaient déjà la terre.
L’équipe a également utilisé des images satellites pour mesurer la distance entre les moutons et les vagues de végétation qui se sont formées. Ensuite, ils ont comparé les performances des animaux à deux types de moutons au cours d’une simulaiton : des moutons naïfs qui se déplaçaient au hasard, et des moutons omniscients qui avaient une parfaite connaissance des plantes locales. « Certains des troupeaux récemment déplacés ne suivaient pas mieux la vague de verdure que ceux qui erraient au hasard », explique Brett Jesmer, qui a dirigé les travaux. Les troupeaux plus anciens ont fait beaucoup mieux, « pas aussi bien que les troupeaux omniscients, mais presque », dit-il.
« Cela change notre façon d’envisager les habitats de la faune et de la flore », ajoute M. Kauffman. « Les chercheurs sur la faune sauvage ont toujours mis l’accent sur le paysage physique. Quelle quantité d’herbe y a-t-il ? Combien de conifères ? Vous pouvez alors vous estimer la qualité de cet habitat pour un tétras des armoises ou un grizzli. Mais notre travail suggère que la véritable mesure de la qualité d’un habitat pour les animaux mobiles est donnée à la fois par les attributs physiques du paysage et les connaissances possédées par les animaux sur la manière d’y vivre. Si l’on place des animaux naïfs dans des habitats impressionnants, leurs performances risquent d’être très médiocres, alors que les animaux qui savent exploiter des paysages dégradés pourraient très bien s’en sortir. »
Les scientifiques se demandent depuis longtemps comment les animaux migrateurs savent où aller. Dans certains cas, cette connaissance est innée. Les bébés tortues de mer lisent le champ magnétique de la Terre pour se diriger dans des directions précises, tandis que les oiseaux chanteurs hybrides suivent des itinéraires situés à mi-chemin entre ceux de leurs parents. Dans d’autres cas, l’apprentissage est clairement important. La migration des grues blanches s’améliore avec l’âge, et les groupes qui comprennent au moins un aîné sont bien plus à même de maintenir leur cap.
Les écologues ont longtemps spéculé sur le fait que les ongulés – les animaux équipés de sabots tels que les cerfs, les bisons et les moutons – apprennent également à migrer, puisque de nombreuses espèces semblent adopter les modèles de déplacement de leurs mères et de leurs pairs. En étudiant les mouflons déplacés, à l’aide de données recueillies sur leurs colliers, l’équipe de Kauffman a finalement confirmé cette hypothèse longuement discutée.
Dans une certaine mesure, les ongulés peuvent trouver de la jeune végétation avec l’odorat et la vue. « Mais ils possèdent également une excellente mémoire spatiale », explique Jesmer. « Ils peuvent se souvenir du moment où un chemin s’est reverdit et chronométrer leurs déplacements pour se rendre dans cette zone au printemps suivant. » Leurs cartes mentales sont le fondement de la migration. Elles marquent la différence entre un animal qui ne fait que chercher des pousses dans une zone restreinte et un autre qui se déplace sur de longues distances sur le terrain dans l’attente de la verdure dont il sait qu’elle arrivera.
Il faut du temps pour acquérir ces connaissances, ce que l’équipe a démontré en étudiant les mouflons et cinq groupes d’orignaux déplacés. Plus ces animaux passaient de temps dans un nouvel endroit, plus leur capacité à « surfer » était bonne et plus ils étaient susceptibles de migrer. Jesmer pense que ce processus se produit probablement sur plusieurs générations : les individus apprennent à se déplacer à travers le monde en suivant leur mère, puis complètent ce savoir-faire hérité par leurs propres expériences. « Chaque génération, vous obtenez cette augmentation progressive des connaissances », dit Jesmer. Pour les moutons, dit-il, apprendre à exploiter efficacement leur environnement prend environ 50 à 60 ans. Pour les élans, il faut plus d’un siècle.
Ce savoir permet aux animaux de trouver les plantes tôt, quand elles sont jeunes, tendres et plus faciles à digérer. Et en mangeant des plantes de qualité, ils peuvent plus facilement se nourrir des graisses et des protéines qui leur permettent de passer des hivers rigoureux. « Lorsqu’ils perdent ces connaissances, leurs populations en souffrent », explique Jesmer.
La conservation des espèces sauvages ne consiste pas seulement à augmenter les chiffres d’une population. C’est aussi un acte de préservation culturelle. Lorsque les rangers empêchent les braconniers de tuer une matriarche éléphant, ils protègent aussi sa mémoire. En préservant les routes par lesquelles les mouflons d’Amérique peuvent se déplacer, ils maintiennent les connaissances traditionnelles des animaux vivants pour les générations futures.
Les pertes culturelles sont plus difficiles à voir que la disparition des habitats ou le déclin des populations, mais elles ne sont pas moins importantes, explique Isabelle-Anne Bisson du Smithsonian Conservation Biology Institute. « C’est un autre angle qu’il est crucial de documenter, face à des changements paysagers et climatiques sans précédent », dit-elle. Les humains ont de plus en plus fragmenté le paysage en morceaux de plus en plus petits. Nous construisons des routes, des clôtures et des villes, ce qui limite les mouvements des animaux sauvages et rend la migration plus difficile.
Conscients de ces problèmes, les conservationnistes ont de plus en plus régulièrement essayé de modifier les clôtures, de créer des passages de faune et de contrecarrer le développement le long des « couloirs de migration ». Mais Kauffman souligne que ces couloirs ne sont pas de vraies choses physiques, comme des pistes ou des routes. « Le corridor existe dans l’esprit de ces animaux », dit-il. « Si vous coupez ce corridor de migration par une autoroute puis le réassemblez avec un pont, les animaux ne recommenceront pas nécessairement à l’utiliser immédiatement, car ils n’en auront pas automatiquement le souvenir. Ils auraient besoin de réapprendre. »